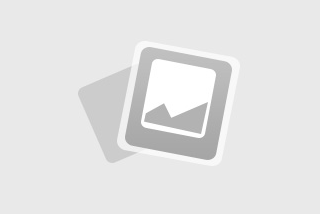Si aucune histoire d’innovation ne se ressemble, tous leurs promoteurs s’accordent à dire qu’il s’agit d’un parcours du combattant, dont l’issue n’est jamais certaine. « Le projet peut exploser tout de suite ou ne jamais sortir. Il peut avancer pendant 10 ans et puis couler », reconnait le directeur de l’IHU de Strasbourg, dédié à la création et à la diffusion de thérapies innovantes guidées par l'image, le Pr Christian Debry. En 2023, la France comptait 2 660 PME healthtechs, dont 820 biotechs, 1 393 medtechs et 450 en numérique en santé/IA. Depuis 2010, les créations d’entreprises ont grimpé, les liquidations aussi. Selon France Biotech, en 2010, on dénombrait 20 liquidations pour 46 créations, soit un solde net de +26 entreprises. Mais en 2023, ce chiffre avait chuté aux alentours de +20 (59 créations, pour 39 échecs). Pour éviter un maximum d’écueils, il convient donc d’être bien préparé. Quelques questions permettent d’évaluer rapidement la viabilité d’un projet, a insisté le Pr Bernard Fraysse, lors du lancement de la Commission innovation de la SFORL, fin septembre 2024. Y a-t-il un besoin ? Celui-ci est-il déjà couvert ? Le projet est-il réalisable ? Existe-t-il un modèle économique pour le soutenir ? « Concrètement, il faut savoir dès le départ comment vous allez gagner de l’argent », a résumé, de manière très prosaïque, la directrice innovation chez CDNO Anjac Anne Beaulieu, lors de ce même évènement.
Protéger ses idées
« Rien ne sert de se lancer si le champ n’est pas dégagé », poursuit le chirurgien ORL à la Pitié-Salpêtrière, Yann Nguyen, qui a participé au développement du robot dédié à la microchirurgie de l’oreille Robotol. La question de la propriété intellectuelle doit être abordée au plus tôt, certains domaines étant déjà verrouillés par un (ou des) brevet(s). Celui-ci protège, pendant 20 ans et sur une aire géographique définie, tout nouveau produit, fruit d’une invention et susceptible d’avoir une application industrielle. Rien n’oblige toutefois l’inventeur à le déposer tout de suite, car la période du développement, des essais cliniques ou du passage au réglementaire sont autant de mois, voire d’années perdues pour l’amortissement du projet. Mais attention, il est indispensable s’il existe un risque de copie. Sa rédaction (et notamment des revendications) nécessite des compétences juridiques et techniques précises. Une fois toutes les démarches effectuées, le délai moyen de délivrance par l’INPI est de 27 mois. À noter que la loi impose à tous les employés de déclarer leur invention à leur employeur.
À lire aussi | â–¶ Le Robotol s’implante au bloc
Selon les données de la Commission européenne, 23 000 DM devaient se faire certifiés, alors que les capacités d’audit ne sont que de 7 000 dossiers par an !
Nicolas Wallaert, fondateur d’iAudiogram
Trouver le bon écosystème et les financements
Une fois ces prérequis passés, « il faut s'accrocher à son idée pendant très longtemps, prévient le Pr Debry. Il faut savoir que vous porterez votre projet seul, mais que vous devez être très bien entouré ! » Spécialistes de la propriété intellectuelle, du réglementaire, des finances, mais également de la recherche ou du développement industriel, les expertises nécessaires doivent être confiées à des professionnels pour éviter le crash. Dans ce contexte, certains environnements tels les incubateurs de start-ups sont particulièrement propices. À Lyon, la start-up Pulse Audition (voir encadré) a intégré l’Inria startup studio, « afin de faire maturer notre projet », raconte son cofondateur Manuel Pariente. Salariés de l’Inria avec son associé pendant un an, ils y ont reçu des formations sur la création d’entreprise ou la recherche de fonds. « En Alsace, nous disposons d’un environnement exceptionnel dans le domaine médical », raconte aussi Christian Debry. L’accélérateur d’innovations en santé Nextmed revendique la mise en relation sur un même territoire de quelque 14 000 professionnels de santé, 3 000 chercheurs, 400 entreprises et 50 start-ups. L’occasion de créer des synergies et de développer des solutions innovantes de prises en charge des patients. On y retrouve le pôle de compétitivité trinational du Grand Est BioValley France (spécialisé dans le médicament, les thérapies innovantes, technologies médicales, diagnostic, et e-santé), les incubateurs Quest for health (dédiés aux start-ups healthtechs, en phase de création ou d’amorçage) et SATT conectus (qui met en relation recherche publique et entreprises). C’est dans cet environnement favorable que la start-up Sounduct (voir encadré) a pris son envol.
À lire aussi | â–¶ À l'essentiel avec... Manuel Pariente, cofondateur de Pulse Audition
En termes de financement, la France est bien dotée. Depuis 2021, le plan d’investissements « France 2030 », pourvu d’un budget de 54 milliards d’euros sur 5 ans, subventionne des projets industriels. En 2023, le président français réaffirmait son engagement dans le domaine de la santé, notamment sur les dispositifs médicaux (DM) innovants, débloquait 500 millions d’euros supplémentaires et annonçait la création de quatre nouveaux « bioclusters » de recherche sur le même modèle et 12 IHU – dont reConnect, qui a été inauguré en novembre 2024 (AD#46). Ce n’est pas tout. « Les sociétés savantes proposent des prix, les incubateurs de start-up lancent des “émergences”, les instituts de recherche, les fondations, les fonds d'investissements ou les business angels accompagnent les entrepreneurs, liste Christian Debry. Il faut aller les chercher. » En 2023, les healthtechs hexagonales ont réuni 1,8 milliard d’euros en levées de fonds. La BPI a de son côté financé à hauteur de 1,2 milliard d’euros.
À lire aussi | â–¶ Sounduct proposera bientôt des aides auditives made in France
Essais cliniques
Une fois les projets bien développés, suivent les étapes des essais précliniques (sécurité du produit) et cliniques (efficacité chez l’humain). Celles-ci nécessitent un savoir-faire que l’on pourra acquérir en interne ou externaliser par le biais des CRO (sociétés de recherche sous contrat). Les études cliniques contrôlées randomisées sont considérées comme la méthodologie de référence. Dans le cadre des DM, il est toutefois possible d’y déroger si les études sont difficiles à mettre en oeuvre, en raison du rythme rapide de développement, du caractère opérateur-dépendant de l’efficacité du DM ou de l’organisation des soins, ou quand les populations cibles sont très restreintes, explique la Cnedimts dans son Guide pour la développement clinique des DM, publié en 2021. Des modes de preuve adaptés devront alors être développés, telles des études expérimentales, en vie réelle ou observationnelles. Quel que soit le type d’étude choisi, « le principe de transparence (...) doit être la règle », insiste l’organisme. Il est aussi possible de solliciter un rendez-vous précoce avec la HAS « pour échanger sur une étude clinique avant sa mise en oeuvre ». Attention aussi au seuil d’efficacité choisi : il peut être difficile à qualifier dans le cadre d’un handicap. C’est l’une des difficultés rencontrées par la société Cilcare (voir encadré). « Nous travaillons sur les premières étapes de la perte auditive, à un moment où le patient ne se rend même pas compte que son audition décline, explique la directrice générale Celia Belline. Cette perte d’audition à peine perceptible annonce pourtant une évolution délétère pour l’audition. » Pour Cilcare, le défi est de démontrer sur un faible échantillon de patients une simple amélioration de l’intelligibilité dans le bruit.
Le réglementaire européen embouteillé
Pour accéder au marché européen, les DM doivent être certifiés par un organisme notifié. Celui-ci délivre alors le marquage CE médical qui garantit la sécurité et des bénéfices cliniques. « Sur l’audiométrie, nous devons respecter 80 normes : électriques, compatibilité électromagnétique, acoustique, sur l’IA, le RGPD, etc., liste le président d’iAudiogram Nicolas Wallaert. Sur certaines normes, le rapport d’un expert indépendant est exigé, afin d’attester de l'absence de conflits d’intérêts. » Un long travail documentaire, qui peut pénaliser les moins aguerris, estiment les experts. Afin de contourner la difficulté, certains ont renoncé à inscrire leur produit comme un DM (comme Pulse Audition), d’autres envisagent de cibler le marché américain pour passer par la FDA, réputée « plus pragmatique ».
À lire aussi | â–¶ Automatisation par IA : l’avenir de l’audiométrie ?
Il faut dire que l’accès au marché européen s’est particulièrement tendu depuis la mise en oeuvre en 2021 de la nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux (MDR, pour medical device regulation) adoptée quatre ans plus tôt. Ce texte encadrant la mise sur le marché des DM a réorganisé en profondeur leur classification et imposé à tous les DM disponibles sur le marché de se faire recertifier. Le nombre de demandes, en plus des nouveaux produits, a donc soudainement bondi. Dans le même temps, le règlement a durci les conditions d’accès à l’accréditation des organismes notifiés habilités à délivrer ces certificats. Résultat, d’une soixantaine avant la réforme, il ne restait plus qu’une dizaine d’organismes notifiés en mai 2021. « Selon les données de la Commission européenne, 23 000 DM devaient se faire certifiés, alors que les capacités d’audit ne sont que de 7 000 dossiers par an !, se désespère Nicolas Wallaert. Pour l’innovation, c’est un carnage. » Le fondateur d’iAudiogram (voir encadré) s’y casse les dents depuis fin 2021. L’intégration de l’IA au sein de son DM a aussi alourdi les démarches car si la règlementation européenne sur l’IA a enfin été adoptée en mars 2024, les normes et les guides nécessaires à son application sont en cours de rédaction. « Le passage par les organismes notifiés a un impact budgétaire et temporaire majeur, prévient Nicolas Wallaert. En fonction des spécialités, il faut compter entre 650 000 et 1,2 million d’euros par an pour l’organisme notifié. » Sans compter les couts liés au retard pris. « L’amortissement sera difficile : entre le début du brevet et l’arrivée sur le marché, la moitié du temps a été grignoté », tempête-t-il. Face à ces difficultés, une résolution proposant de réviser le règlement MDR a été adoptée mi-octobre. Le texte « prie la Commission de tirer pleinement parti des instruments législatifs et non législatifs à sa disposition, en vue de résoudre les problèmes liés aux différences d’interprétation et à l’application pratique, de rationaliser le processus réglementaire, d’améliorer la transparence et d’éliminer le travail administratif superflu des organismes notifiés et des fabricants, en particulier des PME, sans compromettre la sécurité des patients ». Selon nos informations, la résolution devrait être examinée fin mars ou début avril.
Du côté du médicament, aucune contrainte spécifique n’est à noter sur l’ORL puisque « rien n’existe pour l’instant », pointe Celia Belline. Ainsi, les référentiels pour l’évaluation de l’efficacité des traitements sont à définir avec les sociétés savantes, et les leaders d’opinion du secteur. Charge ensuite aux autorités de juger si les propositions thérapeutiques présentent un bénéfice patient suffisant.
À lire aussi | â–¶ MDR, la loi qui ne fait pas rire les fabricants
Industrialisation
Une fois l’innovation validée, la phase d’industrialisation permet de la produire à grande échelle. Cette étape impose de nouvelles contraintes (stérilisation, maintenance, fabrication, etc.) qu’il faut anticiper dès le départ. Les couts deviennent faramineux. « Pour une start-up dans l’innovation médicale, se posera tôt ou tard la question d’un adossement industriel, compte tenu des contraintes capitalistiques de déploiement », prévient le cofondateur de Sounduct Olivier Gauthier. Avec quel moyen lancer la production ? Comment monter en charge ? Quel réseau de distribution et quelle force de vente ? Selon la BPI, en 2021, seules 10 % des sociétés de deeptech en santé qui ont levé au moins 1 million d’euros produisaient en interne. La start-up Pulse Audition est le parfait exemple de ce phénomène : en janvier 2025, elle annonçait son rachat par le géant EssilorLuxottica.